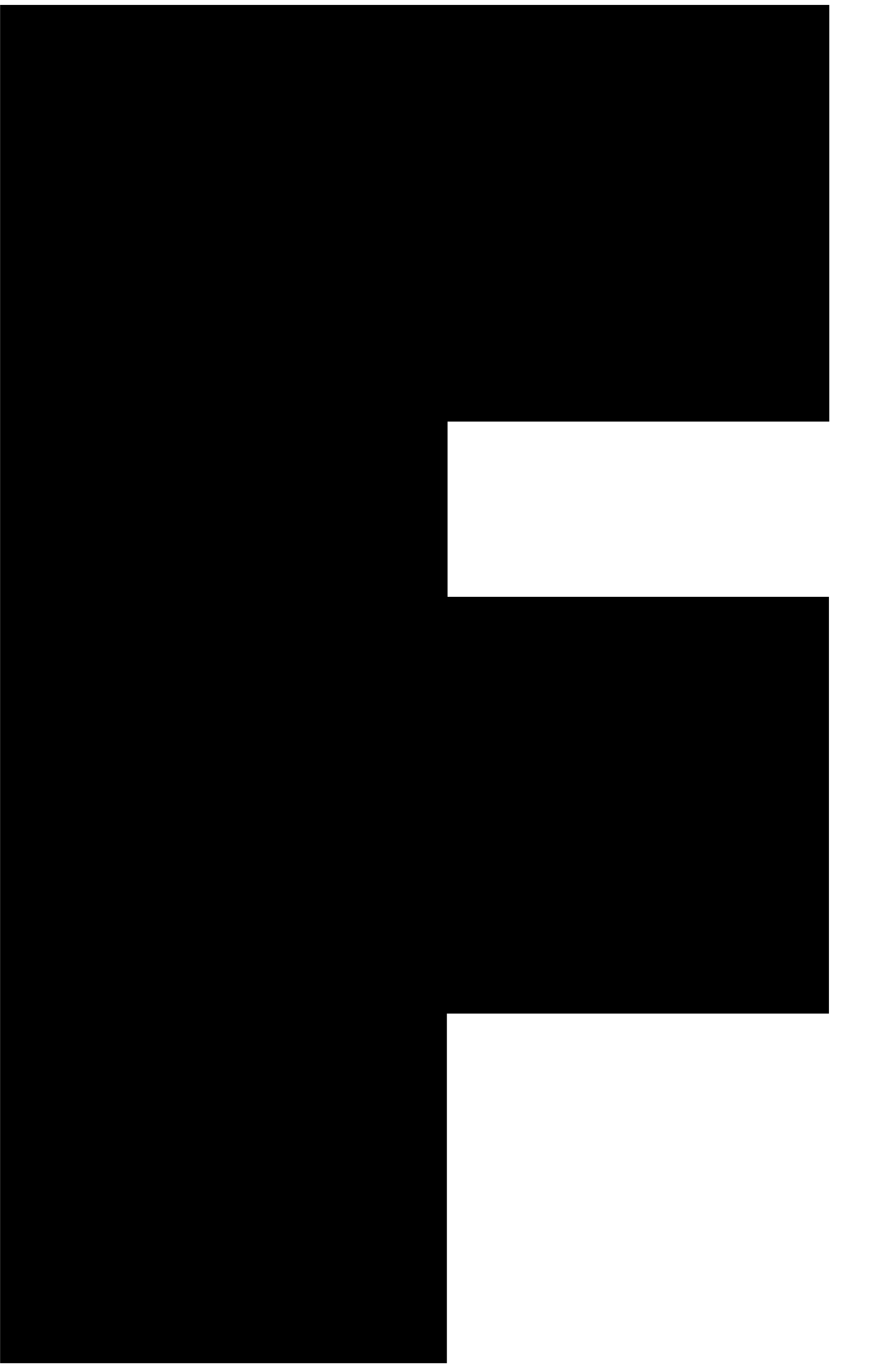Tous, nous avons un jour probablement vu cette image de la lune, blanc sur noir, où elle nous apparaît noyée d’ombre, à demi-grugée, dirait-on, par celle-ci. Alors que le côté sombre semble aller peu à peu vers l’inexistence la plus crue, la part lumineuse montre son relief. En fait, elle le fait de manière d’autant plus manifeste que l’on est aussi confronté à la dissolution de toute matière dans l’autre partie. On croirait voir une sorte de sculpture menacée par un néant peut-être encore actif, grandissant. En cette image, forme sculpturale et nette image en viennent à naître de concert. Elles doivent en fait cette naissance gémellaire à l’ombre dont toutes deux sont issues, l’image devenue encore plus nette du fait qu’elle semble s’extirper du néant, la sculpture aux formes d’autant plus voluptueuses qu’elle provient de la même vacuité.
L’ombre serait ici à la fois mère de la photographie et de la sculpture et c’est par elle que des liens en viennent à se nouer entre l’un et l’autre de ces médiums.
Dans des textes antérieurs, on a souligné tout ce que le rapport de la sculpture avec la photographie pouvait avoir d’allotopique. Comme si photo et sculpture ne pouvaient cohabiter ensemble que par une sorte de résistance active entre l’un et l’autre de ces médiums. Cela est si bien intégré dans le travail de Jocelyne Alloucherie que c’en devient une sorte de jeu. En fait, cadre, grain, formes habitables, silhouettes ombrées, montants, visées sont autant de composantes des œuvres de Jocelyne Alloucherie qui finissent par essaimer hors du médium dont ils sont une part pourtant essentielle. Ils en viennent à exister par eux-mêmes, hors sculpture, hors photographie, mais tout de même pénétrés de ce que ces deux médiums offrent comme conditions de possibilités.
Or, ce jeu d’échanges achoppe sur une composante essentielle des images et masses de l’artiste : l’ombre. Déjà, en 2003[1], il m’apparaissait que la lumière a besoin de l’obstacle de la chose volumineuse pour créer l’image et que cette ombre essentielle est tout aussi nécessaire pour la sculpture dont on ne saurait révéler les formes sans cette caresse lumineuse qui la façonne. Ainsi, est-ce sur le terrain signifiant de l’ombre que sculpture et photographie viennent à se rencontrer.
Dédale représente un pas de plus dans cette direction. D’autant plus que Jocelyne Alloucherie s’essaie à un médium nouveau pour elle : la vidéo. C’est à la ruelle qu’elle consacre toute son attention. Elle continue là le travail commencé avec les découpes d’arbres, puis de constructions urbaines déjà exploitées auparavant (Les Occidents, 2005). Les ruelles, venelles, callejones forment l’épine dorsale des constructions architecturales de nos villes. Elles sont les arrière-fonds, arrière-cours, fondements de notre organisation urbanistique. C’est par leur entremise que certains services, essentiels à la vie, peuvent être donnés aux citoyens. À ce niveau, elles sont cependant plus ou moins tombées en désuétude. On n’y passe plus pour le ramassage des ordures et les fils électriques n’y pendent plus guère. Mais elles sont restées comme un vestige d’organisation architecturale et urbanistique. Dans certaines villes, et je pense à Guanajuato, au Mexique, elles sont plus utilisées, parce que plus rapides et plus pratiques, que les rues (ou calles, en espagnol) réservées aux automobiles.
Au plan formel, elles offrent un condensé des masses et formes que Jocelyne Alloucherie s’est plu, tout au long de sa carrière, à agencer[2]. Elle a d’ailleurs travaillé les tonalités, les ombres, la bande sonore, cherchant un effet esthétique qui dénaturalise la ruelle réelle sans toutefois la trahir. Ce faisant, elle cherche à montrer combien nous habitons des formes qui ne sont pas que des tanières, grouillantes de vie… mais qui le sont aussi.
Dans le chatoiement d’une lumière de fin de journée, oblique, presque pendante, des êtres passent, des animaux s’agitent. Tous, ils affectionnent ces sortes de dépendances qui ne servent plus vraiment à rien mais qu’on aime encore arpenter, lotis dans les méandres de nos habitations s’efforçant, par une autre face, de porter beau.
[1] Je fais ici référence à la page 9 de mon texte dans : Jocelyne Alloucherie. Glissements, Valcourt, Centre Yvonne L. Bombardier, 2003
[2] Notons, de plus, que le mot vient de l’ancien français, « ruiele », qui désigne un passage entre le mur et le lit. L’on sait bien que la référence au mobilier domestique a aussi fait partie de la panoplie de l’artiste (La septième chambre de 1986-87, Table haute, 1979-90).
Jocelyne Alloucherie
Les débuts de la carrière de Jocelyne Alloucherie datent des années 70. L'artiste présente sa première exposition personnelle une installation sur sable, au Musée du Québec en 1973. Dans les années 80, Jocelyne Alloucherie a participé à de nombreux événements artistiques au Canada tels que Aurora borealis (Centre international d'art contemporain de Montréal, 1985) et la Biennale d'art contemporain (Musée des beaux-arts du Canada, 1989) notamment, aux côtés de plusieurs artistes canadiens majeurs.
L'artiste a participé à quelques grandes expositions internationales comme Anninovanta (Bologne, 1991) conçue par Renato Barilli, Différentes natures (Paris, 1993) de Liliana Albertazzi, Libera mente, Museo di Cesena 1997 Alice Rubbini et Peter Weiermair, It. La Disparition, troisième Biennale de Liège, 2002, et, Camere con vista, au Centre Il Filatoio de Caraglio, Andrea Busto It., en 2002 Species d'espays, au Tinglado 2Tarragona, Chantal Grande et Marie-Josée Jean Espagne en 2003, Il Velo en 2007 à Turin, Tout ce qui bouge ne se voit pas, Ttransphotographiques, 2008, Lille, Françoise Paviot, Chambres d'écho, Musée Réattu, Arles, 2009, Michèle Mutashar, à la Galerie des Beaux-Arts de Paris dans L'Arbre et le photographe, 2012, d'Anne-Marie Garcia et de nouveau au Musée Réattu dans Nuage, 2013, de Michèle Mutashar. Depuis le début des années 90, le travail de Jocelyne Alloucherie connaît une visibilité continue à l'étranger, en France et en Italie et en Espagne en particulier, où il est l'objet de nombreuses expositions personnelles. Elle a, entre autres, été présentée dans les événements collatéraux de la Biennale de Venise 2009, par le CRAA de Verbania, avec une exposition personnelle au Palazzo Brandolini Rota. L'artiste est représentée par la Galerie Françoise Paviot (Paris) The 511 Gallery, New York, et Roger Bellemare à Montréal.
La carrière de Jocelyne Alloucherie a été reconnue par plusieurs prix, notamment le prix Martin-Lynch Stanton de Conseil des arts du Canada, en 1989, le prix de la Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) en 1997, le prix Louis Hébert de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1999, le prix du Gouverneur général en arts et arts médiatiques du Conseil des Arts du Canada en 2000 et le prix Paul-Emile Borduas en 2002. Elle a reçu l'Ordre du Canada en 2008.
Commissaire
Sylvain Campeau